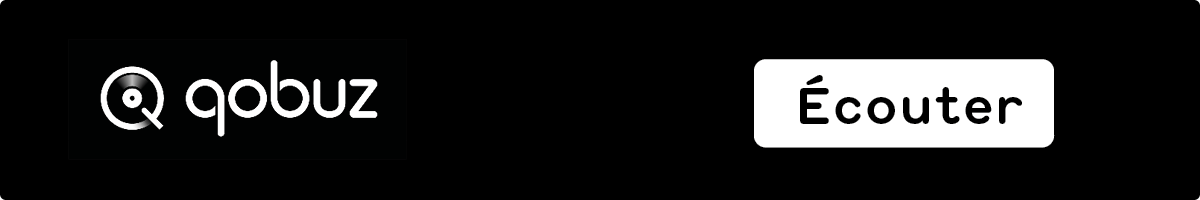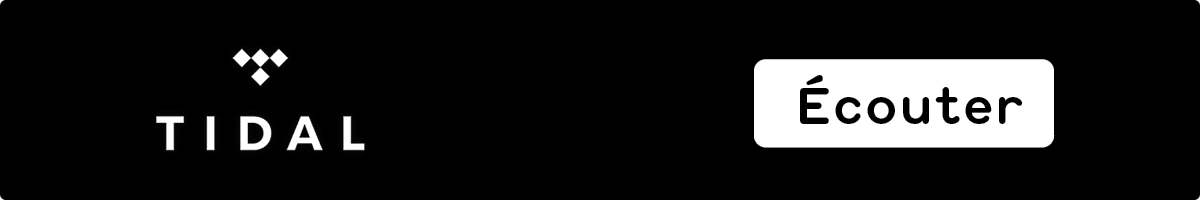Chaque mois, le Centre de musique baroque de Versailles vous concocte une playlist thématique à écouter pour vous immerger dans le répertoire musical français des XVIIe et XVIIIe siècles. Bonne écoute !

Lalande, le Lully latin
Playlist par Thomas Leconte, chercheur et responsable éditorial au CMBV
Né à Paris en 1657, mort à Versailles le 18 juin 1726, Lalande s’impose très tôt comme l’une des figures majeures de la musique française du Grand Siècle. Enfant de chœur à Saint-Germain-l’Auxerrois, brillant organiste et compositeur précoce, il attire dès 1678 l’attention de Louis XIV. Mais c’est en 1683, lors du concours pour pourvoir les charges de sous-maîtres de la Chapelle royale, qu’il entre véritablement au service du roi : son motet Beati quorum remissæ sunt, le « choix du roi », lance sa carrière exceptionnelle. Pendant plus de quarante ans, il dirige la Musique du roi, cumulant les charges à la Chapelle et à la Chambre, façonnant le « son » de Versailles. Il incarne la perfection du style français, partageant avec Lully, Charpentier et Rameau la place parmi les grands noms qui ont défini l’identité sonore de la France du xviiᵉ et xviiiᵉ siècles. Compositeur rigoureux et inventif, il concilie ferveur religieuse, élégance théâtrale et raffinement orchestral.
Si son nom reste indissociable des fameuses Symphonies pour les Soupers du roi, redécouvertes au milieu du xxᵉ siècle, ce sont surtout ses grands motets qui constituent le cœur de son œuvre : 77 compositions pour la messe quotidienne du roi, où s’élabore un art de l’éloquence et de la splendeur sonore typiquement versaillais. Cette playlist en propose un échantillon choisi, exercice délicat tant ses motets rivalisent de beauté. On y retrouve ses premières œuvres pour Louis XIV, écrites dès l’année du concours : Beati quorum et le saisissant Audite cæli, où se manifeste déjà une maîtrise sûre du contrepoint et de la déclamation française.
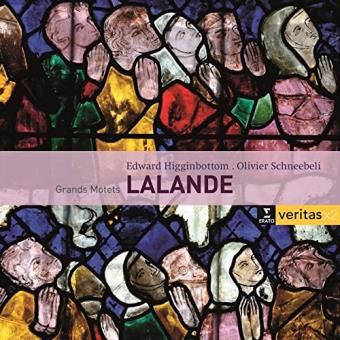
Son style gagne ensuite en densité et en souffle dramatique, perceptible dans la conclusion du Dies iræ (1690), et s’éclaire en luminosité et ampleur, comme dans le verset « Memor erit » du Confitebor tibi (1699). Des motets comme le Venite exultemus (1700) ou le Cantate Domino (1707, avec sa doxologie et son redoutable solo de haute-contre, vanté par les contemporains) traduisent une attention nouvelle : à la forme – les versets sont plus nettement caractérisés, contrastés –, et à l’espace sonore.
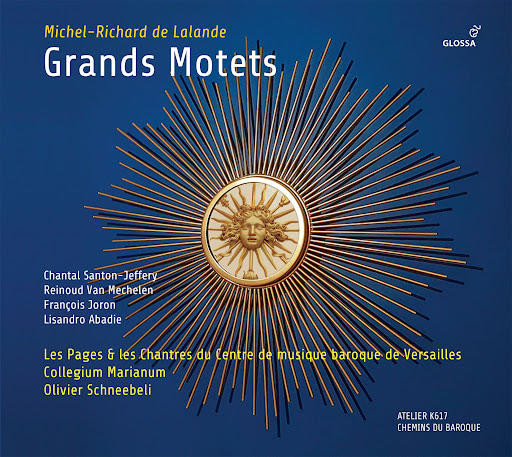
Après la mort de Louis XIV, il retravaille ses motets, dans un souci constant d’évolution esthétique : la version révisée (v. 1715) du De profundis témoigne de sa pleine maturité. D’autres pièces, comme le puissant Te Deum ou, là encore, le Cantate Domino, connurent dans leurs moutures définitives une large postérité hors de la cour, au Concert Spirituel (Paris), mais aussi dans les cathédrales et concerts de province, où elles restèrent au répertoire jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle.
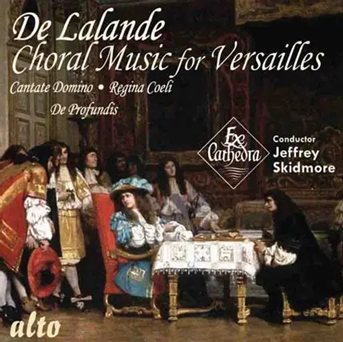
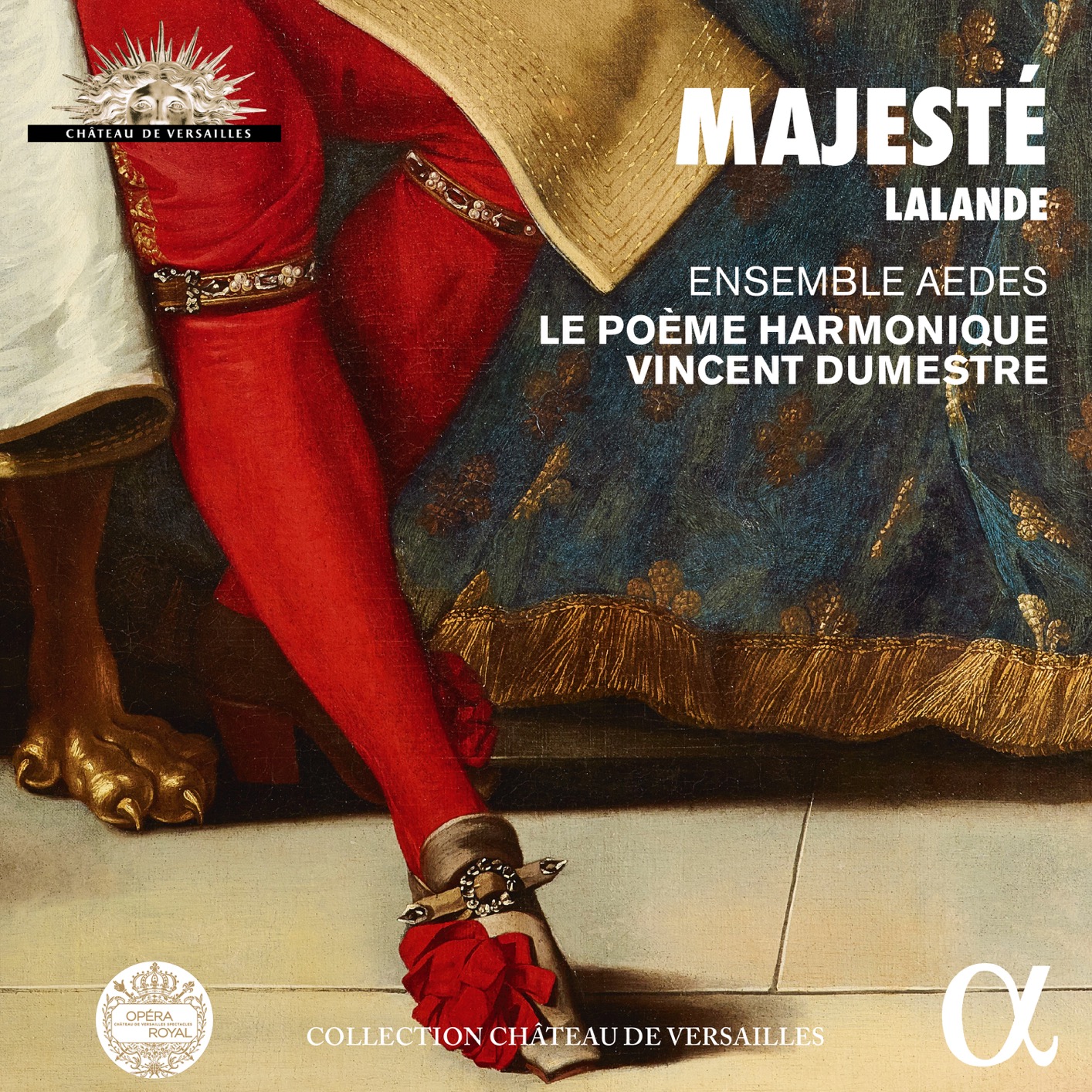
À côté de ces fresques monumentales, il cultive aussi une expression plus intérieure et contemplative. Ses Leçons de Ténèbres, son Miserere à voix seule, sa mise en musique du cantique Sur le bonheur des justes de Racine, pour les demoiselles de Saint-Cyr (v. 1695), révèlent un art d’une grande économie de moyens, empreint d’émotion contenue et d’un sens aigu de la couleur vocale.
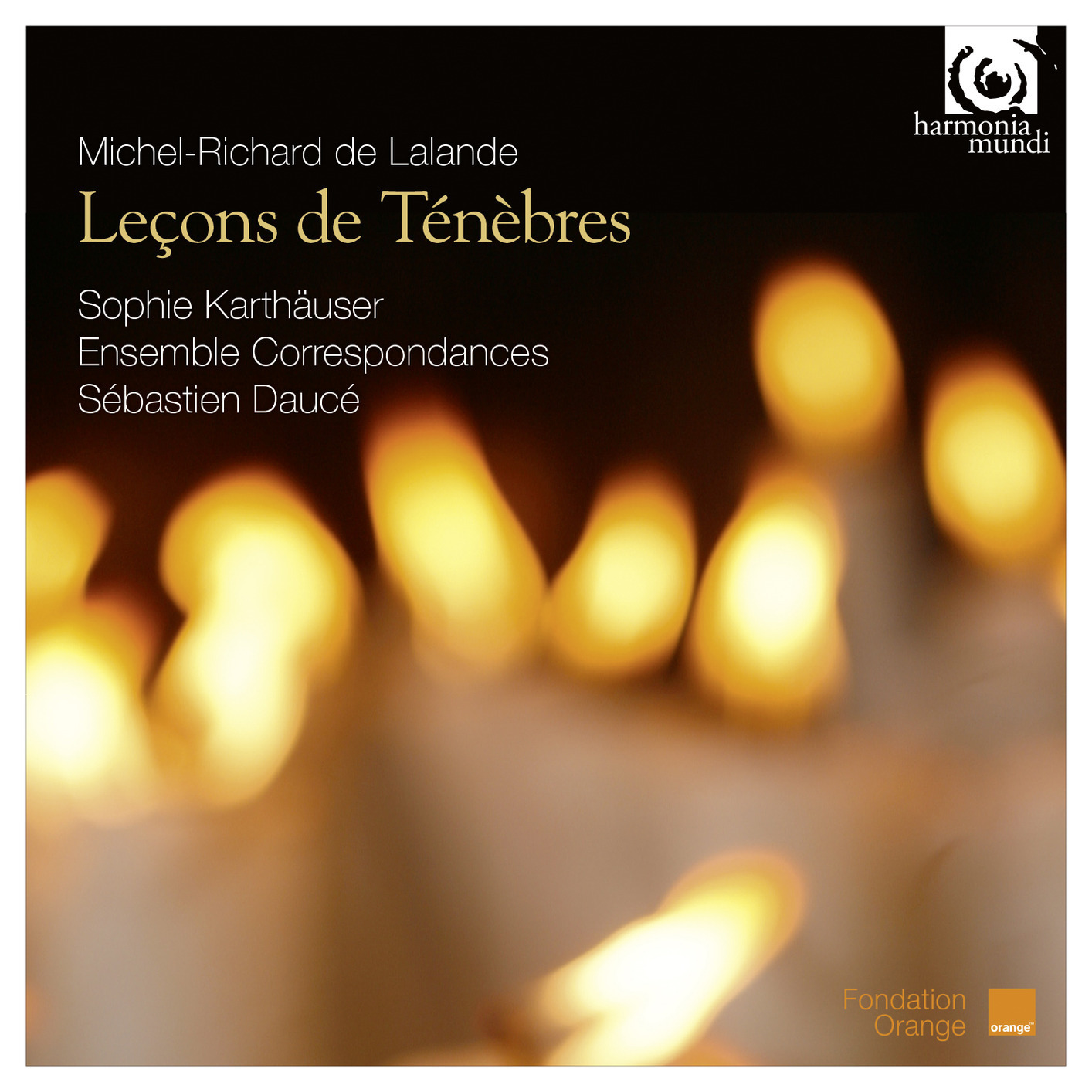
Mais Lalande n’est pas qu’un compositeur religieux : il laisse un corpus important pour les divertissements de cour. Ses Fontaines de Versailles (1683), sa pastorale L’Amour fléchi par la constance (1697) – dont les grands airs, tel « Tant qu’a duré la nuit », sont dignes d’une tragédie en musique –, ou encore les ballets pour Louis XV – L’Inconnu, Les Folies de Cardenio (1720) et Les Éléments (1721, en collaboration avec Destouches) –, dont certains airs se retrouvent dans les Symphonies pour les Soupers du roi, témoignent de sa capacité à unir grâce théâtrale et équilibre.
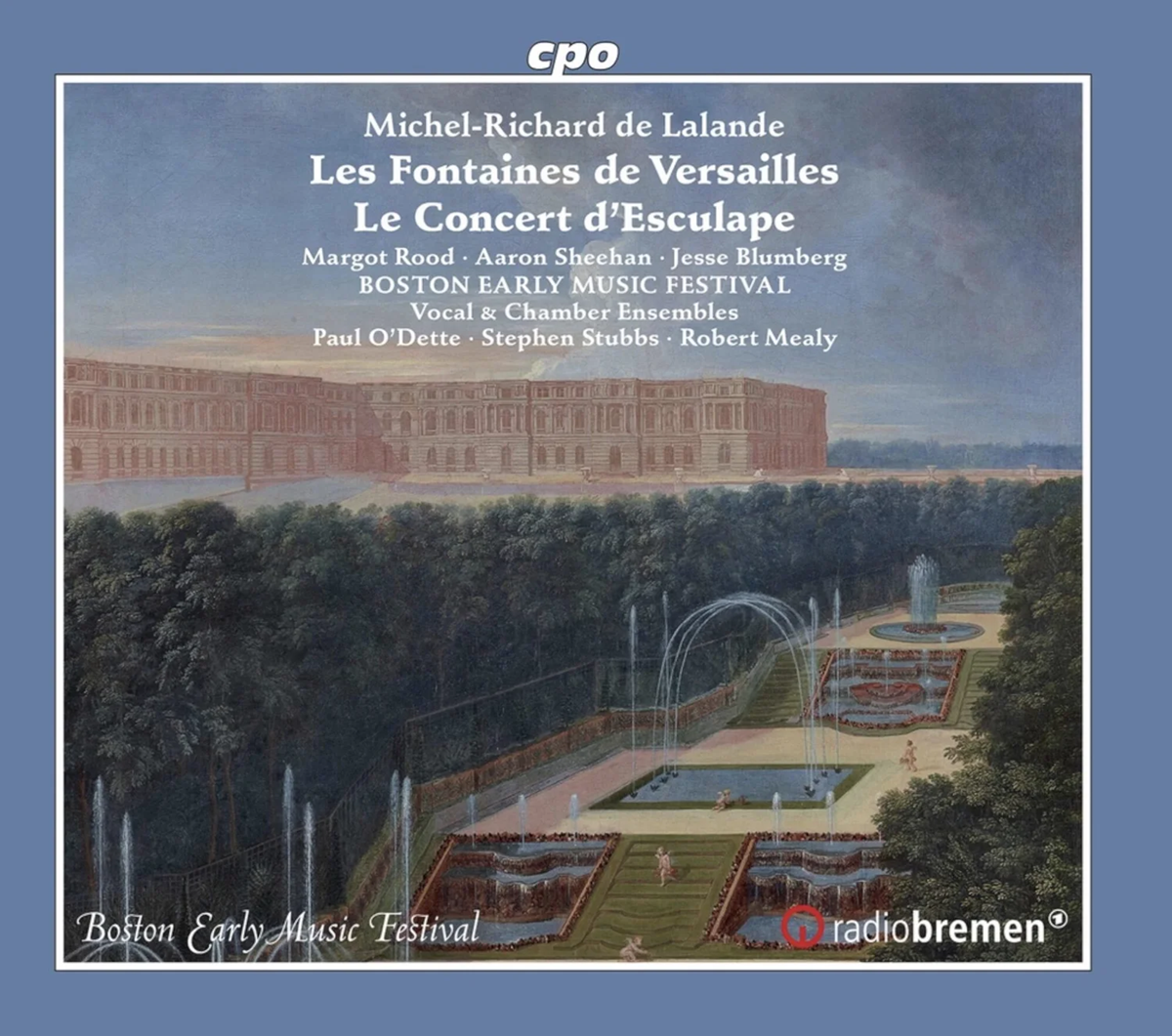
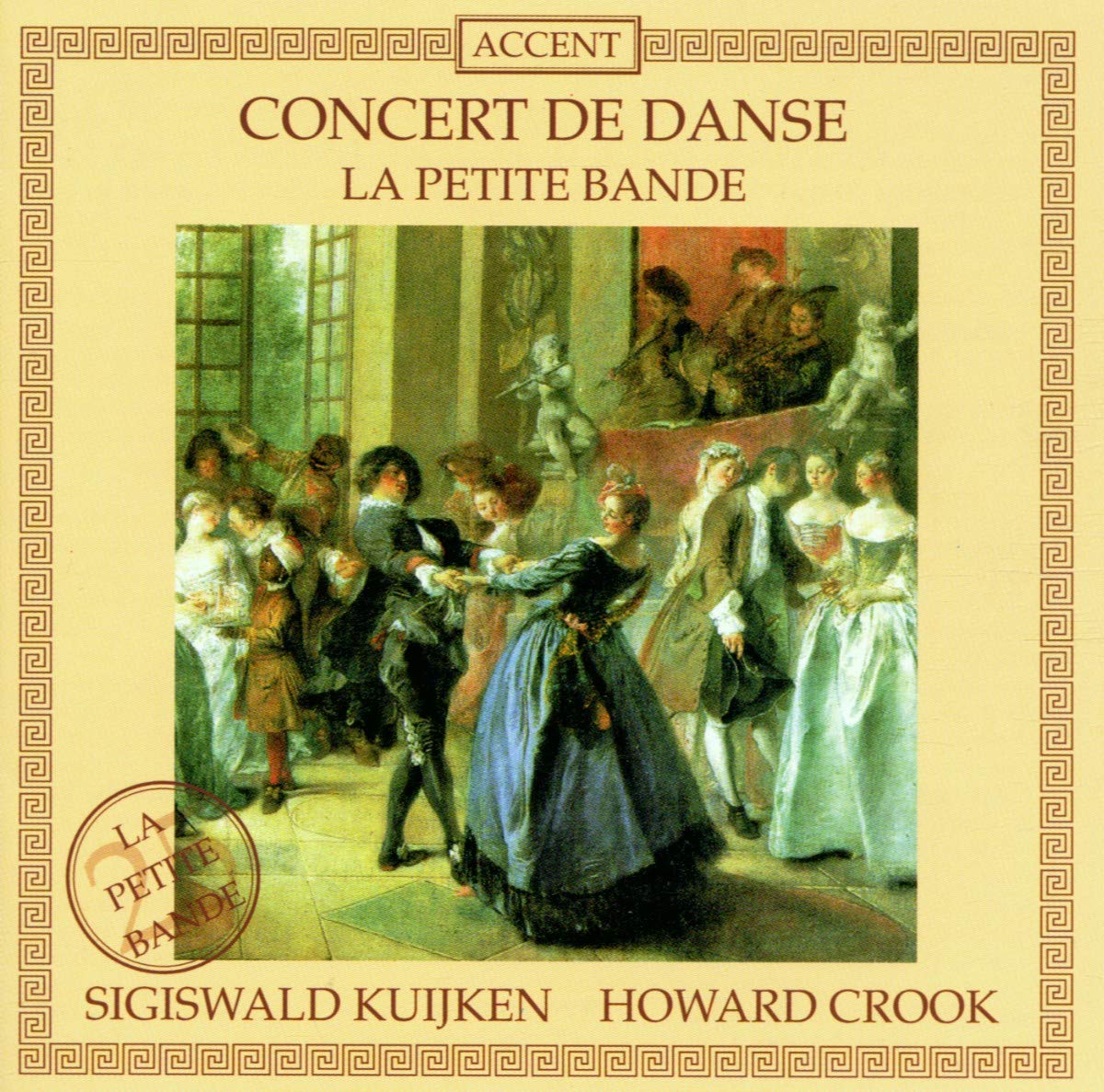
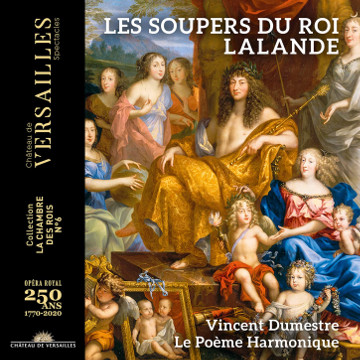
Organiste de formation, Lalande transpose dans l’orchestre son expérience du clavier, avec une attention particulière aux timbres et aux plans sonores, traités comme des registrations d’orgue. Ce goût des couleurs apparaît dès le verset « In noctibus » de son Ecce nunc benedicite (1683), avec un récit de basson obligé, annonçant les recherches des Symphonies pour les Soupers du roi. Destiné aux repas de Louis XIV puis de Louis XV, ce corpus, amorcé dans les années 1690, formalisé en 1703 puis augmenté – près de 300 pièces –, révèle un musicien pour qui la couleur sonore est un véritable langage : les trois « caprices », dont la magnifique Grande Pièce royale, « que le roi demandait souvent », annoncent l’esthétique orchestrale du Siècle des Lumières.
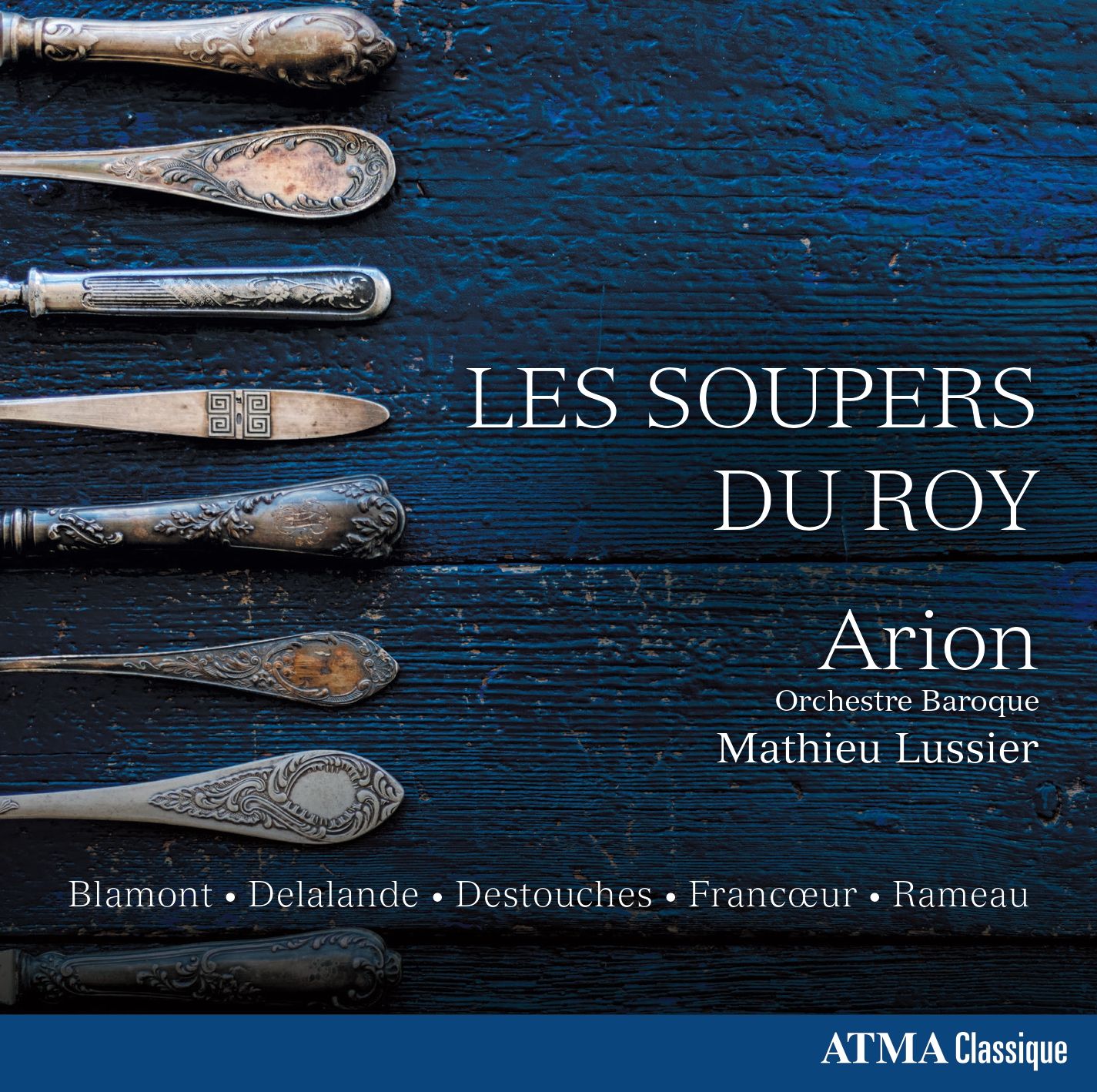
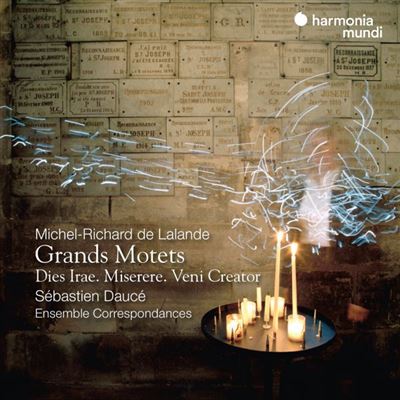
Cette playlist retrace ainsi les multiples visages de Lalande – du musicien du roi au musicien de l’âme, des fastes de Versailles à la dévotion intime, du théâtre à la table royale. Elle invite à parcourir une œuvre cohérente, où s’unissent équilibre classique et recherche expressive, force, ferveur et élégance : un art au service de la beauté, de la foi et du son.